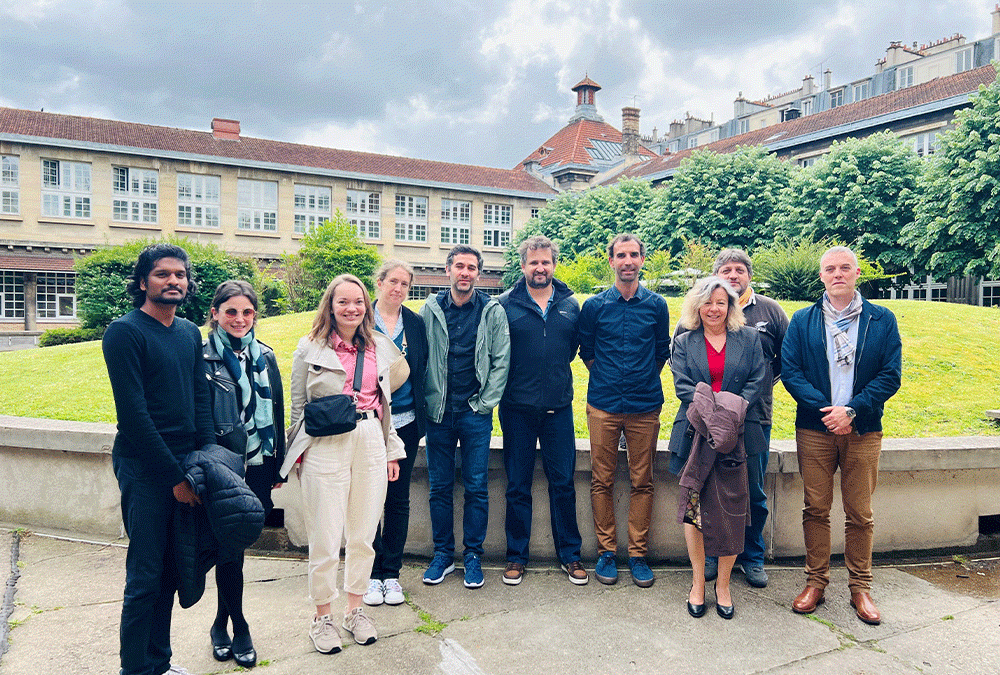SDC2 (Smart Disassembly Cell for Circularity) est l’un des plus ambitieux projets de recherche financés par le Carnot ARTS dans le cadre de sa mission de ressourcement scientifique et d’exploration des technologies de rupture. L’objectif prioritaire est de récupérer, au-delà des ressources matières, des composants ou modules fonctionnels à forte valeur résiduelle pour développer des voies de réparation ou de fabrication. Un vrai projet à impact qui contribuera à intensifier la bascule vers une économie circulaire !
Nicolas PERRY, chercheur Carnot ARTS à I2M de Bordeaux Talence accompagne ce grand projet fédérateur qui rassemble autour des laboratoires Arts et Métiers de Bordeaux, Chambéry, Lille et Metz (I2M, LISPEN, L2EP, LCFC), les partenaires de l’ESTIA Recherche de Bidart, du LAMIH de Valenciennes et les laboratoires grenoblois G2ELAB et G-Scop. Il répond à nos questions.

Nicolas Perry
Quels sont les grands enjeux de ce projet ?
Les enjeux écologiques n’échappent à personne. Désormais, la règlementation pousse les fabricants à afficher leurs indices de réparabilité et va bientôt imposer la réparation et la prolongation de la vie des produits, comme objectif prioritaire de fin de premier usage.
D’un point de vue géostratégique et macro-économique, il est désormais clair qu’il faut gagner en souveraineté matière et composants pour sortir des dépendances d’approvisionnements. Si la récupération fonctionnelle n’est pas pertinente, un sur-tri des composants permettra de flécher des voies de recyclage des matériaux performantes, plutôt que d’avoir recours à un broyage global qui dilue les fraction d’intérêts, tout en réduisant l’efficacité de récupération matière.
En termes économiques, il faut impérativement gagner en performance de traitement des produits. Les opérations de tri et de désassemblage sont encore très manuelles, ce qui réduit leur rentabilité et freine leur généralisation. L’idée est de n’avoir à mobiliser les opérateurs que sur des étapes clés ou critiques.
Il y aura donc également un enjeu humain fort pour assurer la sécurité des opérateurs dans leur nouvel environnement de travail, tout en l’enrichissant des données et de l’aide technologique nécessaires pour piloter et mener l’intégralité du processus de désassemblage.
Le projet a retenu 3 cas d’études. Comment s’est opéré le choix ?
En retenant les moteurs électriques, le gros électroménager et les convertisseurs de puissance, nous avons privilégié des objets qui montent en quantité, en tant que produits en fin de vie.
Les systèmes liés à la transition électrique (moteur électrique, convertisseurs de puissance) ont des enjeux de matériaux et ressources critiques (cuivre, terres rares …). Les études sur les batteries se concentrent actuellement sur les contraintes de sécurité opérateurs pour limiter les risques de chocs électriques et de départs de feu.
Les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) sont un gisement de masse et donc un enjeu fort des filières de recyclage. Nous serons particulièrement attentifs au gros électroménager car il pose des difficultés de manipulation pour les opérateurs et ouvre des voies de réparation, tout autant que de désassemblage.
Plus généralement quels sont les verrous technologiques prioritaires à lever pour accélérer l’adoption des modèles d’économie circulaire ?
L’objectif est de faire pivoter les technologies pour passer de l’industrie 4.0 vers la circularité 4.0.
Le premier verrou est lié à la variabilité produit. Un produit en fin de vie est une somme d’incertitudes, notamment liées sur à ses conditions d’utilisation passées.
Il faut aussi travailler sur la capacité à identifier les composants et pièces d’intérêt à récupérer, non seulement en fonction de leur criticité mais aussi de leurs contraintes et perspectives de recyclage. Selon les marchés, la requalification des composants de seconde vie exigera des tests ou des certifications. Cela devra être anticipé lors des procédures de désassemblage